La mort dans la religion chrétienne et son
Non communiqué
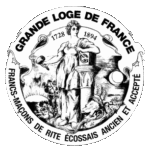
et son symbolisme

Mon propos est d’examiner les liens intimes entre la religion chrétienne et la mort. Après avoir rappelé les notions de bases et les origines du culte de la mort et des religions, je vous exposerai mon analyse en quatre temps :
-Les religions et leurs origines.
-Le culte de la mort dans ces religions, en particulier la religion chrétienne.
-Les évolutions au cours du temps.
-Le symbolisme qui s’y rattache.
Je parlerai entre autre de l’avant mort (le processus de mourir et son accompagnement), de la mort elle-même (les modalités de penser et d’imaginer la mort) et de l’après mort (les rites funéraires et la survie de la communauté).
Les thèmes que je développerai sont la crise de la mort au sein de l’humanité, l’art de bien mourir, la vie après ou au-delà de la mort, la mort comme lieu de la sociabilité.
Tout au long de ce travail, je ferai le rapprochement avec nos symboles maçonniques, tâche simplifiée par le fait que nos traditions et référentiels sont largement communs, mais qui reste ardue car leur interprétation et l’utilisation que nous en faisons diffèrent de façon notable.
En guise de PRÉAMBULE, nous commencerons par Freud, qui disait que…
… « La religion est l’ensemble du langage, des sentiments, des comportements et des signes qui se rapporte à un être (ou à des êtres) surnaturel(s), surnaturel signifiant qui n’appartient ni forces naturelles, ni aux instances humaines, mais qui transcende celle-ci ».
La religion est une composante essentielle des cultures humaines : contemporaine de l’avènement de l’humanité, les pratiques funéraires témoignent de l’existence de rites et de croyances archaïques véhiculant une expérience collective du sacré.
Cela amène d’emblée à se poser un certain nombre de questions : Quelle est la nature de la religion ? A quels besoins répond-elle ? Quel sens les philosophes lui reconnaissent-ils ?
La religion est donc avant tout un ensemble de croyances et de pratiques cultuelles qui régissent la vie collective des sociétés dites « archaïques« , du moins pourrait-on le croire.
Effectivement, ce n’est qu’à une époque récente et sous l’effet de la sécularisation que la Religion tend à devenir une simple institution spécifique régissant la seule conduite privée (et non plus sociale) des personnes qui en font partie et qui la constituent, encore appelées « les croyants », du moins pour les chrétiens ; certains branches de la religion musulmane n’en sont hélas pas encore arrivés là, les médias nous en parlent tous les jours.
Alors, on reprend depuis le début :
« Au commencement, était le … » ???, le quoi au fait ? « Le verbe », pour ne pas dire le mot. (tient, je vous l’ai déjà faite celle-là)
C’est bien ce que nous disent les religions.
L’étymologie incertaine du terme « religion » est controversée depuis l’Antiquité.
Les auteurs chrétiens se réfèrent au latin « religio » par les verbes « ligare, religare » qui veulent dire « lier, relier ». (tient, celle-là aussi je vous l’ai déjà faite).
La
religion serait donc pour eux un lien de piété,
qui aurait pour objet les
relations qu’on entretient avec la divinité et signifierait
« attache
ou dépendance ».
CICERON voit une autre origine, qui semble plus probable : « Religio » se tire de « legere », qui signifie « cueillir, ramasser », ou de « religere », signifiant « recueillir, recollecter «
Ce dernier verbe n’est attesté que par un participe, ce qui est une restitution. CICERON voudrait-il dire : « revenir sur ce qu’on fait, ressaisir par la pensée ou la réflexion, redoublerd’attention et d’application » (comme le pensait Émile BENVENISTE) ?
En tout cas, religion est ici synonyme de scrupule, de soin méticuleux, de ferveur inquiète.
D’autres (comme Mircea ELIADE, spécialiste de l’histoire des religions) estiment que la religion « n’implique pas nécessairement une croyance en Dieu, en des Dieux ou en des esprits, mais se réfère à l’expérience du sacré. »
Ainsi, le Bouddhisme peut-il parfois être confondu avec une religion alors qu’il ne suppose aucune foi en quelque divinité que ce soit : il se contente de définir un ensemble d’interdits.
Aussi, Emile DURKEHEIM (1858 – 1917) définissait-il dans les « Formes élémentaires de la vie religieuse » les choses sacrées comme étant « celles que les interdits protègent et isolent », à l’inverse des choses profanes qui sont « celles auxquelles ces interdits s’appliquent et qui doivent rester à l’écart des premières ».
Par le sacré, l’homme se constitue un univers à la fois protégé, exigeant et prometteur. Il se concilie ainsi l’au-delà de son savoir, de son pouvoir et de son espoir.
Il surmonte sa solitude et son sentiment de déréliction au sein de l’univers en observant des règles et des rites (État de l’homme qui se sent abandonné, isolé, privé de tout secours divin).
Il transmet son expérience du sacré sous forme de récits, le plus souvent mythiques. Il se situe grâce à des initiations et à des mystères.
Peu à peu, l’humanité a spécialisé certains de ses membres dans la connaissance et la pratique du sacré.
En effet, je pense que l’homme n’a vraiment mérité son nom que lorsqu’il a cherché à se relier à ses morts et donc au-delà de la mort.
En tout cas, tout cela remonte bien loin. La Mort est en effet une des premières découvertes de l’homo sapiens, dont un de ses premiers soucis fut celui d’ensevelir les morts.
Le point de départ se situe il y a environ 90.000 ans, quand nos lointains ancêtres ont voulu donner une sépulture à leurs morts, à la différence des animaux.
L’homme de Neandertal (95.000-35.000 avant J.c.) appliquait déjà des rituels funéraires : des litières de fleurs, des offrandes étaient enfermées dans la nuit avec le défunt dans sa tombe.L’homme de Cro-magnon (32.000-12.000 avant J.c.) réalisait des fresques murales accompagnant aussi bien les vivants que les morts (voir à Altamira en Espagne, Lascaux en Dordogne, Pont d’Arc en Ardèche).
Cette inhumation volontaire correspond à un changement d’attitude de ces hommes vis à vis des morts et de la mort, souligné par les premiers signes d’écritures que l’on rencontre à l’intérieur des premiers sanctuaires.
Dès le
Néolithique (10.000-3.000 ans avant J.c.), des
bâtiments à étages sont
dédiés à ces pratiques comme sur le
site de ÇATAL-HUYUK
en Turquie (7ème millénaire), de même
que chez les Aryens (qui signifie « Nobles »)
entre 4.000 et 1.500 avant J.c.
(Ces Aryens sont apparus en Russie méridionale au
4ème millénaire ;
combattants, ils ont pillé et détruit ce
qu’ils ont rencontré en se
déplaçant
vers les plateaux iraniens, où ils s’installent au
3ème millénaire, mais en
assimilant les coutumes des populations locales, l’origine de
la Perse
ancienne, puis ont ensuite continué vers
l’Anatolie, l’Inde et le Gange pour y
fonder les sources de ces civilisations vers 1.500 avant J.c.).
On voit alors apparaître chez les Perses une nouvelle idéologie : le Mazdéisme.
L’homme est libre de faire
la part des choses entre le bien
et le mal : il y a un esprit du mal (AHRIMAN) et un dieu de
lumière (AHURA
ou HAZDA) qui règnent sur les autres dieux.
Les âmes sont immortelles et composées de ces deux
parties : elles seront
soumises au jugement dernier.
En 3.300 avant J.c., les Sumériens utilisent à URUK (en Mésopotamie) des systèmes pictographiques évolués (plus de 700 signes) appliqués sur les objets ou sous forme de fresques, qui sont à la fois des ornements et des textes sacrés en offrandes à des divinités.
On retrouve cette même symbolique chez les Égyptiens dès 3.200 avant J.c., avec les hiéroglyphes : des textes sont gravés sur les parois intérieures des chambres mortuaires des pyramides à partir de 2.330 avant J.c.
Les mêmes raisons et objectifs conduisent les hommes et surtout leurs prêtres à progresser dans leurs moyens de communication et d’expression ; citons entre autre :
l’écriture Cunéiforme (2.400 avant J.c.) ; les VEDA, textes sacrés hindouistes (1.800 et 1.200 avant J.c.) ; les civilisations avancées des Incas, Mayas puis Aztèques (dès 1.500 avant J.c. puis entre 300 et 900 ans de notre ère).
Cela abouti logiquement à plus de complexité, plus de questions et de débats philosophiques, comme dans les écritures et ouvrages des Phéniciens dès 850 avant J.C.
Rappelons que la première tentative de monothéisme (culte du dieu unique ATON) a été imposée entre 1371 et 1354 avant J.c. par Akhenaton sous la 18ème dynastie des pharaons d’Egypte.
Elle a sans-doute inspiré la première vraie religion monothéiste, celle des Juifs, comme le laisse sous-entendre la similitude entre certains textes de cette époque et le psaume 104 de la Bible.
Inversement, j’estime qu’une civilisation est en danger quand elle oublie ses morts et quand elle escamote les rites funéraires.
Les hommes sont en effet passés par les pratiques funéraires puis par celles des liturgies, ce qui leur a permis de passer dans cet espace du sacré (cité plus haut), c’est à dire d’affirmer leur volonté de communiquer avec des forces qui les dépassent et avec l’ordre de l’univers.
Ils reconnaissaient et vénéraient à l’époque le lien privilégier qui existe entre la nature et le sacré, avec la ferveur et la dévotion que l’on devrait encore lui vouer, ce qui est devenu de moins en moins pratiqué au cours du temps.
Les pèlerinages et les processions deviennent alors progressivement l’expression collective d’un sentiment religieux, essentiellement individuel à l’origine, ce qui continue par contre d’être encore le cas aujourd’hui.
Ce déplacement vers un lieu exceptionnel de spiritualité est le plus souvent collectif ; il permet à chacun de reprendre courage et confiance grâce au contact avec le divin.
Les pèlerinages existent dans toutes les religions, de Lourdes à La Mecque, en passant par Bénarès : ils ont pour objectif de modifier le pèlerin, extérieur aux milieux et sociétés qu’il traverse ; cette étrangeté vécue le fait « muter » et passer à une nouvelle naissance dans ce parcours aboutissant dans un temps et un lieu sacrés après divers obstacles, parfois initiatiques.
Cela aboutit logiquement à la création de lieux de culte, ou Temples, dont la première vraie référence remonte aux Sumériens, en Mésopotamie (au 3ème millénaire) : les Ziggourats, constitués de plusieurs étages formant une superposition de plate-formes décroissantes empilées, le Haut étant le plus prés du Divin.
De grands cataclysmes terrestres commencent à être décrit dans les différentes cultures et religions, comme le déluge :
La première description date des Sumériens du 2ème millénaire, dans l’épopée de Gilgamesh (tablette X), qui est une méditation sur la mort et l’immortalité.
Après, vous connaissez tous la suit
La mort dans la religion chrétienne
et son symbolisme
e :
Abraham et ses fils, puis Moïse et ses tribulations ; ensuite, Bouddha et son « assise » ; après, Confucius et ses entretiens ; viennent enfin Jésus et son sacrifice par amour des hommes, puis Mahomet et ses expéditions.
Le fondement principal de ces divers courants de pensées n’a en rien changé par rapport aux premières croyances : tout au plus a t’il évolué et s’est-il affiné.
La religion est donc là pour aider à se poser les vrais questions, comme nous le faisons : qui sommes-nous, que faisons-nous, où allons-nous ? (Tient, ça me rappelle quelque-chose !)
Avec la sépulture naît la culture : elle porte les humains non seulement à disposer matériellement des cadavres mais aussi à restaurer le lien social, troublé par la mort, et à chercher une réponse spécifique à la question de la mort, dont ils ont peur.
Ainsi, il est juste de considérer la mort comme fondatrice de la culture.
La découverte de la mort sonne aussi l’heure de la découverte du religieux, car les religions explorent le mystère de la mort qu’elles entourent de paroles et de gestes, de chants et de danses, afin de combattre leurs peurs.
« Et le Christianisme dans tout ça ? », me direz-vous. Il est né au 1er siècle de notre ère (je crois !).
Il est basé sur des textes référents (l’Ancien et le Nouveau Testament) et régi par un Pape (le chef de l’Eglise), reconnu comme le descendant de St Pierre par les seuls catholiques.
Les chrétiens croient en l’immortalité de l’âme humaine et au jugement dernier : le Paradis est accessible à ceux qui proclament le Salut par la foi en Jésus-Christ dont la mort efface les péchés du monde ; les autres, qui rejettent le Christ, iront en Enfer.
Cet Enfer chrétien n’est pas détaillé dans les évangiles : il a été construit au cours des siècles à partir de traditions populaires, d’un fond mythologique et de savantes constructions intellectuelles, aboutissant à la création d’un abîme infernal constitué de neuf cercles : les visions, les sermons et l’art de la fin du Moyen Âge ont ainsi édifié une terrible menace qui pèse en permanence sur la vie des fidèles.
Les chrétiens interprètent ces deux aspects de l’Au-delà de différentes manières :
Certains, surtout au début,
opposent l’accomplissement de
l’union avec Dieu (le Paradis, le Salut) au vide de son
éloignement (l’Enfer).
D’autres, insistent davantage sur la nature sociale et collective du
Paradis : c’est là où les
âmes sont en communion les unes avec les autres,
ainsi qu’avec l’Eglise. Sur terre, ceci se fait à
travers la prière et le culte
chrétien ; dans l’au-delà, on
ne sait pas !
En fait, on sait peu de choses sur cet Au-delà : la Bible parle du Royaume de Dieu, du sein d’Abraham, d’un lieu de repos, etc., … des promesses faites pour assouvir les espoirs de rédemption et de vie éternelle.
Pour le Chrétien, c’est par le corps que chacun d’entre nous est en rapport avec le monde. Le paradis est un lieu décrit comme exquis. Mais « Nul ne rejoint le Très-Saint, s’il n’est lui-même sanctifié ». L’enfer, lui, est la séparation d’avec Dieu.
Des évolutions ont eu lieu au cours du temps, ponctuées par l’apparition de différents rites, sans pour autant modifier réellement les fondements de la vraie pensée chrétienne vis à vis de la Mort.
Les débats modernes opposent l’Universalisme (« Tous pour un », tous les hommes seront sauvés) et le Particularisme (le Salut pour les uns, la condamnation pour les autres).
Un premier courant (que l’on pourrait assimiler aux « Old Charges » des Anciens) table sur l’amour absolu de Dieu : personne ne sera damné.
Le second (les « New Charges » des Modernes) met en avant le caractère moral absolu de Dieu et affirme que les pécheurs (et/ou non-croyants) seront rejetés pour l’éternité.
Ce débat anime toujours la communauté religieuse chrétienne d’aujourd’hui.
Par contre, la croix a fini par devenir le vrai centre du rituel chrétien des funérailles (en particulier chez les catholiques), même si elle ne leur est pas spécifique à l’origine.
En effet, les premiers chrétiens s’identifiaient dans leur sépulture par un poisson stylisé, proche de la représentation mathématique du signe de l’infini (tout un symbole). Ceci était plutôt fondé sur la notion de secret en raison des risques de mauvais traitements.
Par la suite, la croix devient
« leur CROIX »,
même si sa forme et la manière dont le Christ y
est « cloué »
ne sont ni une vérité médicale, ni une
réalité historique : cette CROIX
qui « s’étend sur le
monde » signifie que l’Église
fait un
pas vers l’achèvement du corps mystique du Christ au travers
de la mort de
chacun de ses membres.
Dans l’ombre qu’elle porte sur la terre, derrière le
cercueil qui roule dans
son fourgon noir constellé de regrets éternels et
de fleurs périssables, se
déroule un impressionnant cortège d’images,
suscitées par deux millénaires de
liturgie funèbre.
On entend comme dans un rêve la cloche sonner
le glas, les prières
bourdonnantes des pénitents accompagnant la
dépouille, le frémissement dans les
hautes nefs gothiques, tandis que des chœurs
angéliques entonnent le
« miserere » ou le « de profundis ».
En effet, le christianisme a une vision glorieuse de la Mort tel que reprise dans ses rituels.
Elle représente une victoire sur la vie, éclatant dans un ruissellement d’orgues sous les voûtes des cathédrales, emportant l’âme du chrétien dans l’insondable perspective de la transcendance divine. Cela correspond au Rite du passage de vie à trépas, suivit d’une renaissance.
Depuis des siècles, le croyant espère en la résurrection individuelle telle celle de Jésus, lui arrachant un cri de triomphe célèbre, celui-là même que poussa le saint Paul aveuglé de lumière mystique : « Mort ou est ta victoire ? Mort ou est ton aiguillon ? ».
La mort est en soi mal et résolution du mal, exigeant de l’être un abandon total à Dieu, dépouillé de la substance de son ego pour revêtir le vêtement intangible de l’immortalité.
Que nous dit la Bible de cette vie après la mort ? Rien de précis !
Qu’il y aura « le
jour du jugement dernier »,
où tous les morts comparaîtront devant Dieu et
seront jugés d’après l’attitude
qu’ils auront prise à l’égard de
Jésus-Christ.
Ceux qui auront cru en lui pour le pardon de leurs
péchés entreront dans le
royaume de Dieu. Les non-croyants iront au châtiment
éternel.
Jésus a
déclaré que sa vie, sa mort et sa
résurrection
inauguraient un âge nouveau. II parachèvera son
oeuvre en donnant aux croyants
un corps nouveau (comme le sien après sa
résurrection) et en les faisant
participer à la nouvelle création.
Les chrétiens ne croient donc pas seulement à la
survie de l’esprit, mais aussi
à la résurrection du corps.
L’Ancien Testament décrit
la mort comme un état de
ténèbres, de silence et de repos :
personne ne revient de la tombe (ce n’est pas exactement
notre cas en
franc-maçonnerie), mais la mort ne met pas pour autant fin
à l’existence. Dieu
est en effet capable d’arracher l’homme à la tombe (ce
dernier point nous en
rapproche plus).
Le Nouveau Testament
précise ce tableau : les morts
«dorment», mais il y a une différence
entre ceux qui sont morts en croyant au
Christ et ceux qui l’ont rejeté :
Les croyants sont « avec le Christ »,
les autres sont des
« esprits en prison ».
Pour le RITE CATHOLIQUE, la Mort est une entrée dans la plénitude de la vie nouvelle du royaume de Dieu. Chacun devient pleinement participant de la vie de Dieu.
La Mort est une sortie de l’univers, du temps et de l’espace libérant l’Âme.
Il y a encore peut de temps, on pratiquait trois jours de veille avant l’inhumation ; l’office, les fleurs, les bougies et les prières correspondent à l’illumination et l’éclosion de l’âme dans le monde de l’esprit afin d’aider le défunt à passer du matériel à au-delà.
Dans le RITE PROTESTANT, la Mort est une promesse de Résurrection, une Espérance de vie éternelle, la découverte d’une plénitude nouvelle, un passage auprès de Dieu.
Il est ponctué par des funérailles et un office (avec prières, lectures et culte), représentant une participation à la Sainte-Cène, en vue d’accompagner la famille et les amis.
L’existence
de l’âme est
traditionnellement vue en trois étapes pour ces
derniers : la vie ici-bas,
la période entre la mort et la résurrection
finale (une sorte de sommeil), puis
la résurrection proprement dite, à la fin des
temps.
Selon
un autre courant de
pensée, enfer et paradis sont sur terre et le croyant est
déjà passé de la mort
à la vie. La mort n’est pas pour autant vu comme une
impasse, mais comme une
porte ouverte. Sur quoi ? On l’ignore.
Pour
d’autres encore, la
spéculation sur l’au-delà n’a pas de sens et la
résurrection est à prendre au
sens symbolique. Enfin, il y a aussi des adeptes de la
réincarnation.
Le RITE ORTHODOXE GREC OU RUSSE voit la Mort comme une naissance à la vie nouvelle, la rentrée dans la vie spirituelle. Nous vivons ici dans la pensée de la vie à venir.
La mort dans la religion chrétienne
et son symbolisme
Les fleurs, les bougies et les prières de l’office religieux correspondent à ce qui se passe sur le plan spirituel : l’illumination et l’éclosion de l’âme dans le monde de l’esprit (notons que le corps est traditionnellement porté à l’église cercueil ouvert).
L’âme va se purifier et accomplir l’effort de détachement de l’enveloppe corporelle durant les 40 jours prévus pour son l’ascension vers Dieu.
Le paradis (notion développée en Orient, comme le rite Orthodoxe, dans un monde de chaleur et de sable) est vu comme un jardin. C’est un état de vie dans la présence de Dieu. L’enfer, c’est l’inverse, la séparation d’avec Dieu.
Il y a deux formes de mort : L’agonie (expérience douloureuse de celui qui ne veut pas quitter son enveloppe charnelle) et la dormition (dans laquelle celui qui s’endort s’est préparé et vit la mort comme un passage, une Pâque).
Comme on peut le voir, ces deux derniers millénaires ont été marqués par une nette évolution de la symbolique de la mort pour l’homme en général et chez les chrétiens en particulier.
Dans les premières hagiographies latines, les dimensions morales et pathétiques de la mort cèdent la place à des dimensions sacrales d’admiration, mais aussi de crainte.
Ce sentiment de la mort devient tout
à fait original chez
Dante : éprouvant le vide et l’absence,
il se sent contraint de développer
une « stratégie du sens » ; il présente
l’apothéose d’un enfer
médiéval où les méchants
sont punis avec d’extraordinaires raffinements.
Guidé par Virgile dans la Divine Comédie, sa
visite dans un enfer rigoureusement
structuré met fin à une longue tradition de
descentes aux Enfers amorcée deux
milles ans avant J.c., dans le mythe mésopotamien de
Gilgamesh où Enkikou
raconte sa descente aux enfers.
La faisabilité d’un discours sur la mort devient donc une priorité : au cours des temps, elle est faite d’alternance entre l’évitement et la redécouverte de la mort ; elle est partagée entre l’espoir de scruter la mort comme expérience humaine et celui de la considérer comme lieu de production du sens pour la vie, à travers des rites comme ceux de la disposition du corps.
La mort ainsi gérée permet alors à la communauté des vivants de se structurer un nouvel espace relationnel et de remodeler le tissu social afin d’assurer sa continuité.
La filiation de la mort avec la couleur vient appuyer ces rites symboliques : Blanc pour l’espoir (mariage) et noir pour la crainte (deuil), en occident, ou l’inverse en orient et en méditerranée.
Le siècle des Lumières a élaboré une vision de la mort qui s’est largement émancipée de l’héritage religieux.
La survie dans l’affection des proches et dans la mémoire collective de la cité deviendra primordiale. L’« immortalité » n’est plus d’ordre métaphysique ou transcendantal, elle devient civique.
Le marxisme historique, à son tour, souligne la signification collective de la mort comme une dure victoire de l’espèce sur l’individu. Il abolit l’angoisse de la mort par la compensation d’une immortalité pour le genre humain : dans l’histoire et dans la nature.
Parmi les formes d’évitement de la
La mort dans la religion chrétienne
et son symbolisme
mort, on peut considérer la mort comme un phénomène normal pour le renouvellement de la société et le maintien de son infrastructure, ou encore comme une étape obligée de la croissance vers la maturité.
Ainsi, la mort s’inscrit dans une idéologie du progrès, individuel ou collectif, comme un enjeu de la lutte contre la maladie, la vieillesse et les autres limites de l’existence.
La mort finit par apparaître comme un accident qui échappe au contrôle de la rationalité. Ou bien on maintient l’espoir de la prolongation de la vie sur terre par la victoire sur la mort, ou bien on entrevoit la vie après la mort comme un décalque de la vie présente.
Face à la finitude de l’existence humaine, la mort et la résurrection de Jésus sont exemplaires du sens de la mort pour les humains qui aspirent à la plénitude d’être : La discontinuité réelle de la vie est enfin vaincue par l’espérance de la nouveauté du Royaume de Dieu.
Enjolivée, la mort devient finalement une mort niée au 20ème siècle. D’abord partie intégrante de la vie, elle a peu à peu dévié vers l’évitement : Pourquoi ? Sans doute pour de multiples raisons :
La montée progressive de l’individualisme. La transformation du concept de la famille. L’hospitalisation et la médicalisation de la mort. Le primat de la technologie sur les conduites symboliques. La chute de la religiosité traditionnelle et la difficulté de la théologie à traduire une eschatologie significative pour les fidèles. Le refus culturel du deuil relégué à la sphère privée. Le déplacement du rite des églises vers les complexes funéraires.
En effet, la mort était assumée traditionnellement par la religion ; elle est désormais confiée à la thanatopraxie.
Les obsèques effectuent un déplacement du sacré dans l’imaginaire de la mort, notamment dans la représentation du cadavre.
Francis DUCLUZEAU le
détaille très bien dans son ouvrage
« La Mort dans tous ses
états » : il parle de « mariage
raté » entre la vie et la mort dans nos
sociétés modernes, niant de manière
pathologique la mort, au point que, ne sachant mourir, nous ne savons
pas non
plus vivre.
Cela rend plus que jamais indispensable la
nécessité de remettre en place un
art de mourir.
C’est ce que l’on commence à constater ces dernières années : une tentative de redécouverte sociale et médicale de la mort permettrait une meilleure acceptation de celle-ci.
On parle souvent de l’acte
de mourir, du malade, parfois du
mourant, mais rarement de la mort comme telle. À force
d’en parler beaucoup, on
finit par croire que le savoir sur la mort a
progressé ; mais la mort
elle-même échappe à
l’intelligence humaine et, dès lors, on est dans
l’impossibilité d’un acte de
réflexion sur l’acte de mourir.
On l’envisage alors comme un rappel nécessaire de
l’insuffisance de la pensée
qui n’a pas de prise existentielle sur l’instant de
la mort. Cependant, le
sommeil et le vieillissement offrent des analogies et des
préfigurations de la
mort.
Si l’interrogation est
déjà une voie de la connaissance, il
faut admettre que le christianisme n’apporte pas de vraie
réponse à la question
de la mort : il n’annonce qu’une promesse.
En effet, l’espérance en une vie nouvelle et
transformée naît de
l’expérience
de la négativité de la mort. Or de cette
façon, au lieu de s’approcher de la
mort comme finitude, on l’aborde sous l’angle de la
finalité au-delà de la
mort, au risque d’occulter la mort elle-même.
L’accompagnement de la
personne mourante est une partie
intégrante du rituel funéraire ou, du moins, un
geste rituel qui prépare à la
mort. La fonction des rites est précisément la
« mise en sens »
de l’existence devant le non-sens de la mort et la
représentation de
« l’irreprésentable »
de la mort.
Selon la mentalité des prêtres de
l’Ancien Régime, la « bonne
mort »
est celle que l’on prépare et que l’on
apprivoise durant la vie. Mais, à
l’heure du départ, les sacrements de la
pénitence et de l’extrême-onction ainsi
que le saint viatique aident le chrétien à
éviter l’enfer et à entrer au ciel.
La mort à craindre, c’est la mort subite, celle
qui nous prive de la
possibilité de se mettre en paix avec Dieu.
Dans la culture palliative, la « bonne
mort » est une mort
douce et digne. On cherche à rendre la fin de vie plus
significative grâce à
une médication destinée à
contrôler la douleur et à un accompagnement qui
associe les besoins physiques aux besoins relationnels et spirituels de
la
personne.
S’il faut reconnaître les motivations religieuses au cœur de ce projet éthique, il faut garder un oeil critique. Ainsi, le religieux joue le rôle d’un adjuvant de la rationalité médicale dans les soins palliatifs. Néanmoins, la raison instrumentale peut servir d’adjuvant au projet éthico religieux, tout en formulant des réserves à l’égard d’une acceptation trop positive de la mort.
Là où les soins palliatifs cherchent à intégrer la mort à la vie (la mort est ce qui ne peut pas être intégré dans l’existence), le risque est de s’enfermer dans le piège d’un modèle unique d’une mort douce et sereine qui ne correspond pas toujours à la réalité vécue par la personne mourante.
Contrairement à une idée reçue, j’affirme que le rite ne permet pas d’apprivoiser la mort. À l’inverse, il donne acte à la rupture et met en scène le refus culturel d’intégrer la mort dans la vie.
Ce désir de mort symbolique ou enchantée est marquée par l’accroissement des descriptions d’expériences de mort imminente (EMI) : ceci révèle un besoin poignant d’espérance métaphysique face à un monde dominé par les progrès de la rationalité scientifique et de la technique.
Ces expériences de mort imminente sont déjà sous-entendues par Jean de la Croix dans « Le chant du signe » ; il y interprète les voies purgatives et illuminatives, la vocation ascétique suscitées par les étapes proches de la mort, la conversion à une vie plus ouverte à autrui.
Des théologiens estiment que les rites et discours chrétiens tendent à masquer le caractère tragique de la mort qui est pourtant une expérience d’inachèvement et d’absence au monde.
Pour eux, la Mort constitue la fin
totale de l’existence
personnelle et de la relation au monde de la communication.
L’effort fait pour
l’apprivoiser ne supprimera pourtant jamais la douleur de la
séparation et
l’angoisse de l’inconnu. On peut
néanmoins regretter la disparition du tragique
suite à l’édulcoration de la vie et de
la mort.
Dans une culture linéaire comme la nôtre, la
majorité des gens rêvent d’une
éternité après la mort qui
n’est que prolongement de la vie. Seule une
minorité, consciente de la finitude de cette vie, met son
espoir dans une
éternité au-delà de la mort.
L’au-delà est la
« scène »
d’une
existence toute autre qui est en rupture radicale avec le
présent de la vie.
L’attente intense de la première génération de chrétiens à Thessalonique fut centrée sur la résurrection et la venue du Seigneur. Leur désir était de rompre, le plus tôt possible, avec le monde d’ici-bas pour « être avec Le Seigneur ».
Ce désir de la
proximité divine contraste avec la
représentation du shé’ol,
séjour des morts et lieu de l’oubli, où
la mort
constitue l’absence de toute relation avec Dieu.
Dans l’héritage
juif, la discontinuité
bat son plein tandis que, dans la
sensibilité chrétienne, la rupture donne lieu
à une relation avec Dieu
radicalement différente et dominée par la
surprise devant l’imprévisible de la
création nouvelle.
Cependant, tout cet héritage religieux représente
la mort dans une perspective
de continuité.
Sous une forme ou une autre, toutes les religions considèrent la mort comme un passage, comme la naissance à une autre vie. La mort n’est pas la mort, elle est « seuil, passage, transmutation, métamorphose ».
Citons le
remarquable système d’espace-temps
conçu par la civilisation égyptienne, qui
frappe par sa cohérence interne, ou encore le rite
particulier de la « danse
des morts » chez les Hurons, qui aide les
âmes à franchir l’étape de
la mort et à s’engager dans un long voyage, ou
celui de la « fête des
morts » chez les Mohawks, où
la mort apparaît comme une étape vers
une vie prochaine, la naissance et la mort étant
inextricablement liées dans un
dualisme d’oppositions et de ressemblances, comme chez les
chrétiens.
Dans la célèbre préface de la messe
des défunts, on chante bien que « La
vie n’est pas détruite, elle est
transformée. ».
Le discours religieux traditionnel introduit dans la mort une
expérience
« du même »
et « de l’autre »
selon une
logique qui oppose un double espace et une double
temporalité : la terre
et le ciel, le corps et l’âme, le temps et
l’éternité, le blanc et le noir,
…
etc.
La mort elle-même devient une béance qui rend
possible une échappée vers un
ailleurs, au-delà de la mort, et vers un état de
jouissance au-delà de la
souffrance.
Cette logique de la similitude (après la vie) et de la
différence (au-delà de
la mort) participe au paradoxe de la mort :
continuité et rupture.
En CONCLUSION, disons que la mort nous unit tous. Un lien étrange et anxiogène… En effet, peu importe notre conception, nous mourrons.
Elisabeth Kübler-Ross le décrit parfaitement sous le titre « Accueillir la mort » :
Que l’on soit croyant ou non-croyant, si nous arrivons à intégrer le fait que nos disparus continuent à nous apprendre par ce que nous avons partagé, cela permettra de changer en profondeur notre relation à la mort.
L’analyse des rites et métaphysiques propres aux trois religions d’Abraham, de l’hindouisme, du bouddhisme tibétain et du Zen, permet à l’auteur ZÉNO BIANU de tracer un chemin de vie :
« Seuil, passage, transmutation, métamorphose – la mort qu’évoquent les spiritualités,
en Orient comme en Occident, n’est en vérité qu’une à peine mort.
Non qu’elle soit niée dans son indiscutable réalité biologique,
mais elle ne saurait être la fin de tout.
Quelque chose subsiste.
Impérissablement.
Quelque chose nous survit.
Loin de nous clore, cette mort-là nous fait éclore. »
(Dans « Sagesses de la mort en Orient et en Occident »).
Laissons à Nietzsche le mot de la fin :
« Qu’il est étrange que cette unique certitude et cette unique communion ne puissent rien sur les hommes, et qu’il n’y ait rien de plus loin de leur esprit que l’idée de sentir
cette fraternité de la mort! »
Jean Baptiste LOI
